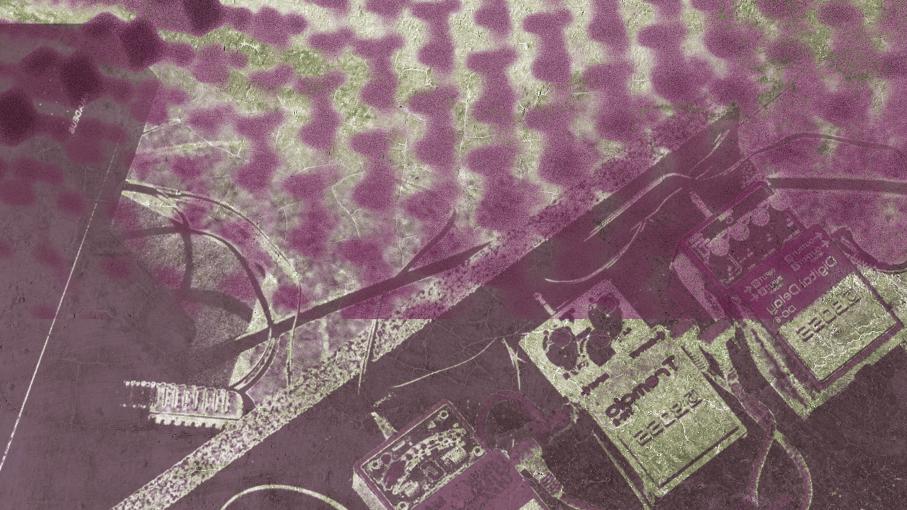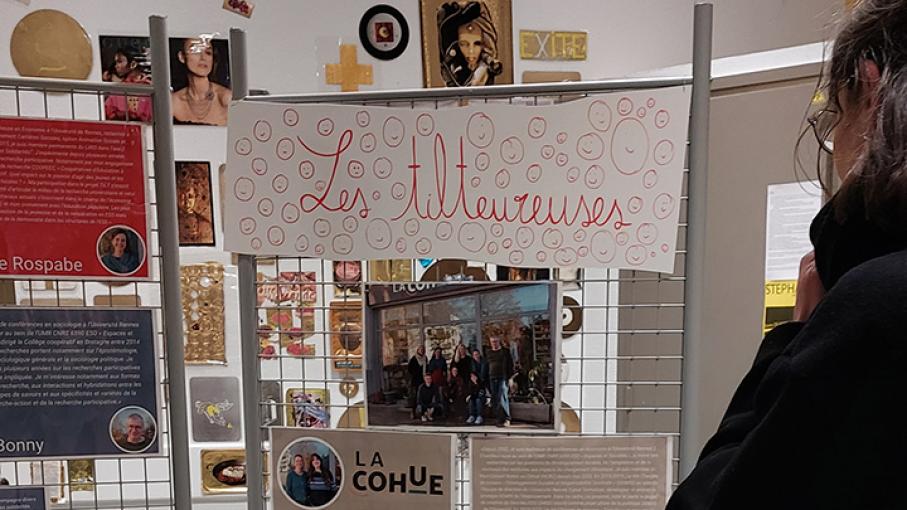En chiffres
Texte/chiffre à mettre en avant
22000
Suite du texte
Étudiant·es
Texte/chiffre à mettre en avant
3000
Suite du texte
Étudiant·es internation·ales·aux
Texte/chiffre à mettre en avant
21
Suite du texte
Unités de recherche, dont 5 équipes associées au CNRS